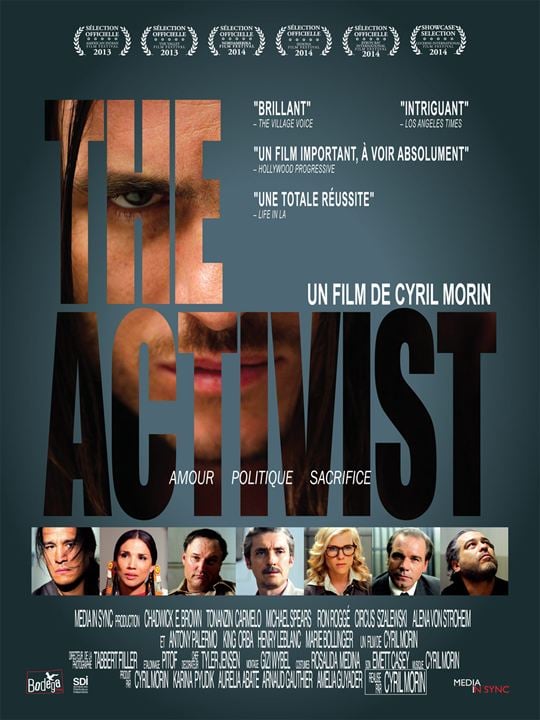 **
**
The Activist (2014) de Cyril Morin
Wounded Knee,
février 1973.
Dans
cette petite ville du Dakota du Sud (tristement célèbre pour avoir été, en février 1890, le haut lieu d’un fait
glorieux perpétré la glorieuse armée des Etats-Unis d’Amérique, à savoir
l’assassinat pur et simple de 350 Amérindiens de tous âges et des deux sexes)
et quatre-vingt trois ans après les faits, Marvin Brown et Bud Ward, deux
activistes de la cause amérindienne
(l’un d’eux est le jeune veuf d’une Indienne morte dans des
circonstances suspectes et l’autre est le cousin de cette Indienne) sont
arrêtés par deux flics locaux.
Mais très rapidement,
le poste reçoit la visite d’un « conseiller » du président Nixon,
suivi du « don » d’un poste de radio (dûment et secrètement équipé
d’un micro), alors qu’une mystérieuse camionnette stationne à proximité du
poste de police.
Le problème des réalisateurs débutants, c’est que,
depuis 1941 et un certain Citizen Kane
d’un jeune réalisateur débutant nommé Orson Welles, ils sont tous persuadés
depuis l’enfance qu’ils sont LE nouvel Orson Welles.
Ils oublient un peu vite que Welles
était déjà un cinéaste amateur, un réalisateur radio et un génial
touche-à-tout, ce que tout le monde ne peut pas être.
Ils « s’amusent » donc à
s’imposer des trucs que certains réalisateurs chevronnés ne font que contraints
et forcés.
Ici, c’est le huis-clos dans la petite
prison d’un poste de police, pendant les évènements de Wounded Knee aux temps
peu glorieux de la présidence du mafieux Nixon.
Tout cela est assez poussif, même si la
réalisation est bien mieux maîtrisée que le récit et si l’interprétation, sans
être stupéfiante, réussit à être convaincante.
En revanche, Cyril Morin réussit assez
bien à distiller le climat délétère et paranoïaque, instauré par la clique de
gangsters protofascistes, descendants directs des McCarthy et autres J. Edgar
Hoover (congédié, du reste, pendant les années Nixon : les paranos
s’éliminent entre eux, c’est normal !) et ancêtres eux-mêmes des Reagan et
des tarés Bush, père et fils[1].
Tout cela est très sympathique, mais ne
hisse pas ce film auquel on voudrait souscrire au rang d’inoubliable.
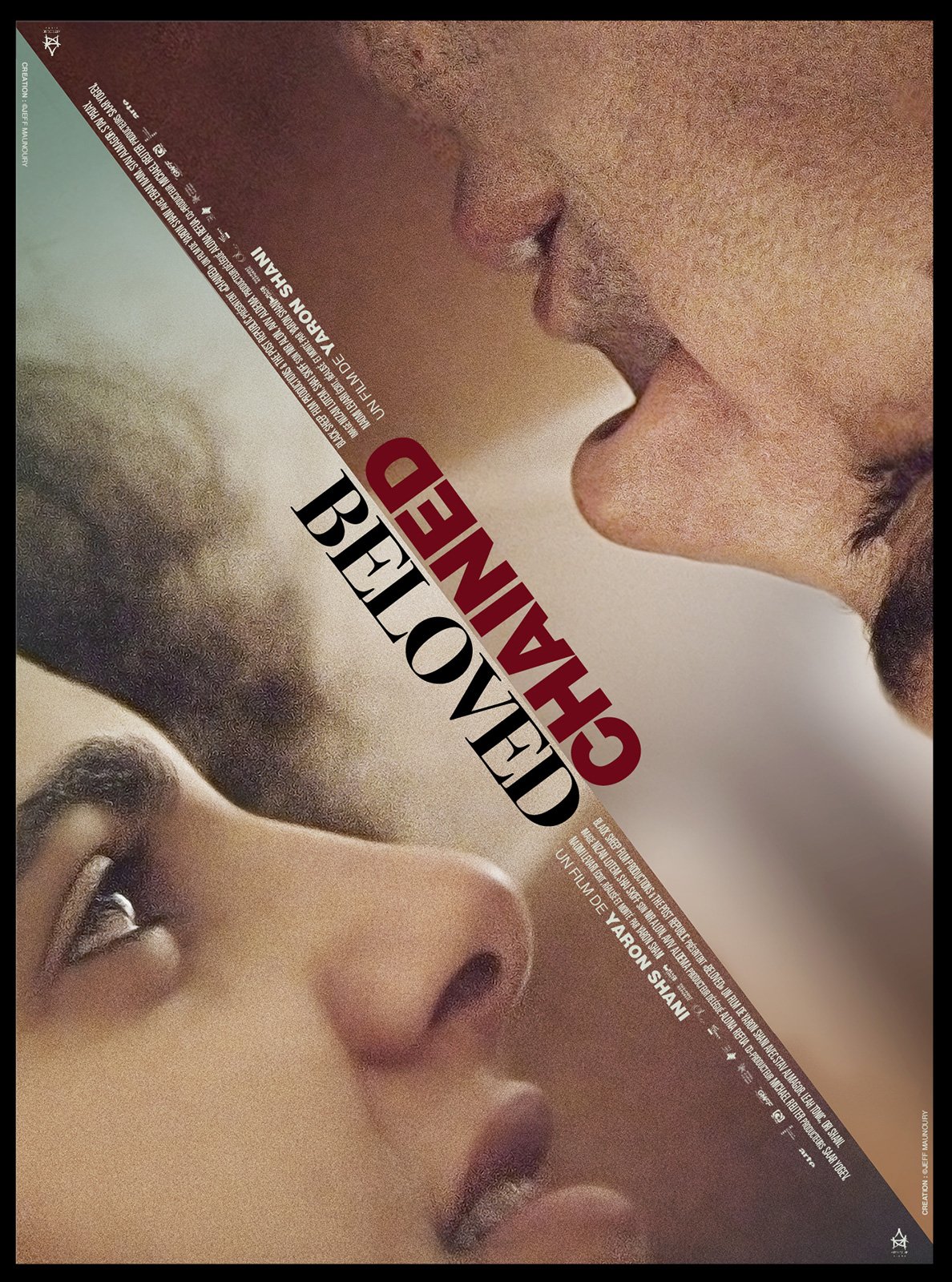 **
**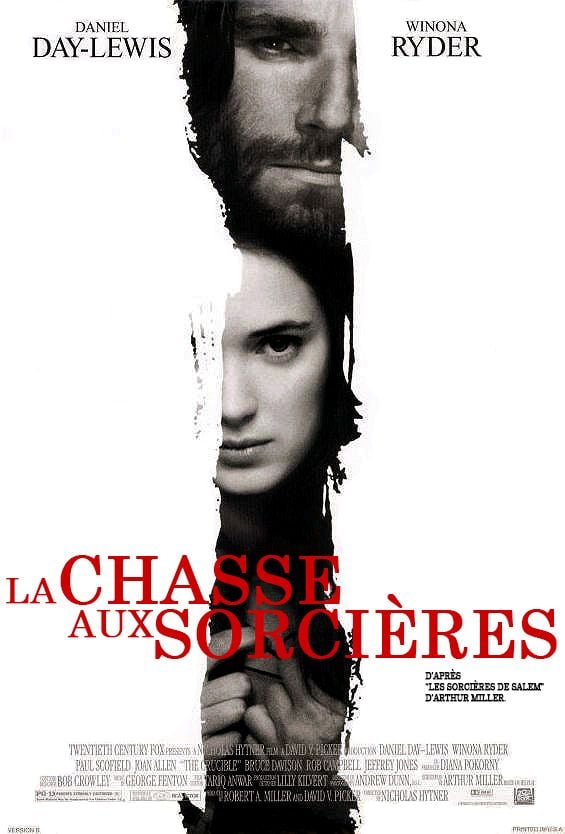 *
*