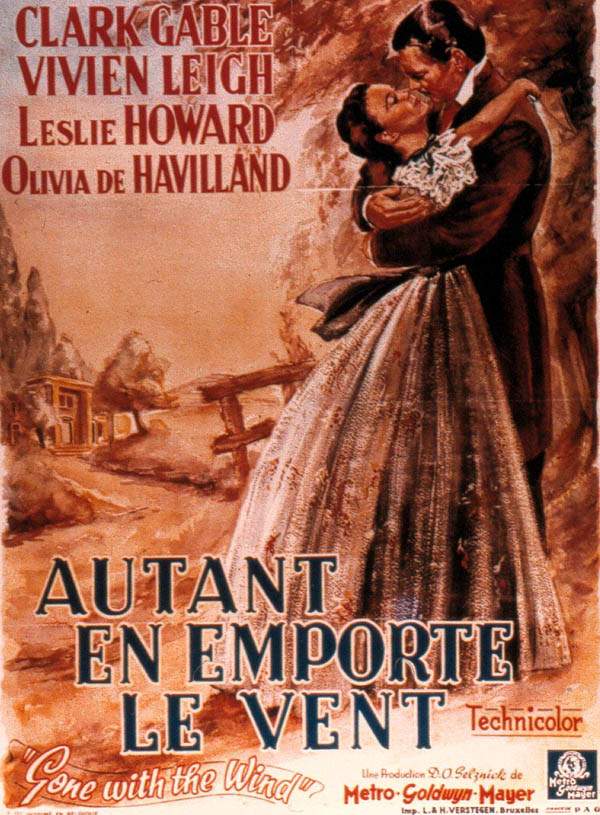 ***
***
Gone With the Wind (Autant
en emporte le vent) de Victor Fleming (1939)
Scarlett O’Hara est une
jeune fille de la bonne société géorgienne, de ces familles de planteurs de
coton, prospères, chevaleresques et… avec beaucoup d’esclaves à leur service.
En cette
veille de pique-nique aux « Douze chênes », la propriété des Wilkes,
voisins des O’Hara, Scarlett est lasse d’entendre parler de la guerre qui
risque d’éclater entre les états du nord et douze états du sud, dont la Géorgie.
Pour elle, la seule chose qui compte, c’est la confidence que lui font deux de
ses (nombreux) soupirants des fiançailles de Melanie Hamilton avec son cousin
Ashley Wilkes. Et Scarlett, dont tous les jeunes gens du comté sont amoureux,
n’a d’yeux que pour Ashley.
En bonne
enfant gâtée, Scarlett décide que tout s’arrangera lorsqu’elle aura avoué son
amour à Ashley. Mais rien ne s’arrange et, comble de catastrophe, Rhett Butler,
un fils de famille d’Atlanta dont la conduite scandaleuse est de notoriété
publique, a été témoin de la scène « de ménage » qu’elle vient de
faire à Ashley.
Et c’est à
ce moment qu’arrive la vraie catastrophe. Au nord, le président Lincoln a
décrété la mobilisation générale pour attaquer les états confédérés du sud.
La guerre de sécession vient
de commencer : elle va durer trois ans, trois années qui vont voir
l’effondrement du sud et la fin du monde des Wilkes et des O’Hara.
Evidemment, tout le monde a
en tête les records faramineux de ce monument : les plus grandes stars
hollywoodiennes se battant pour obtenir le rôle de Scarlett (qui échut
finalement à une Anglaise), les trois réalisateurs, les dizaines de
scénaristes. On a tout dit du projet de Selznick.
Car le
producteur avait le génie de la publicité et celle d’Autant en emporte le
vent fait maintenant partie de la mythologie. Lorsque le film obtint
l’oscar du meilleur film, on le remit à son producteur, comme c’est l’usage,
mais jamais cela ne fut plus justifié, car ce n’est ni un film de Cukor, ni un
film de Wood, ni un film de Fleming, mais bien un film de David O. Selznick.
La postérité
sera à la hauteur : champion toutes catégories du nombre de spectateurs,
film le plus rentable de 1939 à 1963 (soit 24 ans alors que ses successeurs ne resteront
premiers qu’entre 6 mois et 10 ans), remonté trente ans après sa réalisation en
70 millimètres,
chacune de ses ressorties est un succès, chacun de ses passages télévisés un
événement.
C’est la
production la plus caractéristique du système hollywoodien, le film d’un auteur
qui n’est ni scénariste, ni réalisateur, ce qui explique qu’il fut boudé, voire
vilipendé par la nouvelle vague.
D’un point de
vue strictement cinématographique, il est loin d’être parfait : le
scénario doit sans doute ses carences au nombre invraisemblable de scénaristes
qui ont tripatouillé le script original de Sidney Howard, mais malgré trois
réalisateurs successifs, le film reste cohérent tout au long de ses trois
heures quarante-cinq de projection.
Pour ce qui
est de l’interprétation et surtout des quatre vedettes, si les femmes (Vivien
Leigh et Olivia de Havilland) sont parfaites, on sera plus réservé sur le jeu
très daté de Leslie Howard et très peu nuancé de Clark Gable. Les seconds rôles
sont, eux, d’une qualité exceptionnelle. En-tête de ces seconds rôles, la
grande Hattie Mac Daniel qui, avec le rôle de Mamie, fut la première femme de
couleur à obtenir l’oscar, un oscar ô combien mérité.
Tout cela
fait plus penser à un « coup » qu’à une œuvre d’art, mais un coup de
cette envergure, n’est-il pas une œuvre d’art ?
5 janvier 2018
Après avoir revu
tous les bonus, j’avais prévu de regarder le film en DVD, mais la programmation
de Noël d’Arte m’a pris de vitesse et j’ai revu le film en VF, une version
française un peu piaillante comme on les faisait à l’époque (le film est sorti
en France en mai 1950).
A part ça,
rien à ajouter ou à retrancher de ce que j’en ai dit, il y a 17 ans.
Si ce n’est,
les différentes versions qui nous ont été données de l’éviction de George
Cukor. En fait, il y en a trois : l’officielle, la semi-officieuse, la
furieusement officieuse.
L’officielle,
c’est une franche divergence de vue entre Selznick et son réalisateur. La
semi-officielle, c’est que Gable, peu confiant dans la direction d’acteurs de
Cukor, réputé comme réalisateur de femmes, aurait insisté pour faire engager
Fleming qui était un copain du comédien, un homme, un vrai, un tatoué et non
pas une « tarlouze ». La furieusement officieuse concerne directement
à la fois Clark Gable et l’homosexualité : Gable jouissait (si je puis
dire) à son arrivée à Hollywood d’un… « très gros atout » qui n’avait
rien à voir avec un quelconque talent de comédien. Cet atout plaisait
naturellement beaucoup dans un certain milieu, milieu dans lequel un bruit
d’une telle ampleur ne pouvait qu’être relayé et Gable, inconnu et débutant sans
le sou, en aurait vécu. En conséquence, Cukor, bien que n’ayant eu aucun de ces
« rapports commerciaux » avec le futur interprète de Rhett Butler,
aurait pu en avoir connaissance par certains de ses « amis » qui,
eux, auraient « succombé » (et payé !). D’où l’insistance de
Gable pour faire virer Cukor…
C’est, du
moins, ce que prétend Kenneth Anger dans ses mémoires. Anger est probablement
une sale langue de pute, mais par esprit de corporatisme (je suis moi-même une
langue de pute…), j’ai tendance à lui accorder crédit.
19 juin 2020
Non, je n’ai
pas revu le film en question pour la énième fois, mais les tragiques évènements
récents ont remis Autant en emporte le vent sur la sellette : il
fallait bien qu’un jour LA question de l’apologie du sud et des esclavagistes
confédérés (qui ont encore beaucoup d’adeptes aux États-Unis – et pas que !
–) soit mise en exergue car on est bien obligé (et c’est heureux !) de
tenir compte de ça ! (comme disait Jean-Luc Godard aux critiques de cinéma
au Festival de Cannes 1968 : « Je
vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez
travelling et gros plan ! Vous êtes des cons ! »).
Depuis le meurtre de George Floyd à
Minneapolis le 25 mai 2020 par un policier blanc (fasciste et coutumier du
fait, semble-t-il !), le racisme, plaie endémique et surtout systémique de
la société américaine, est revenu sur le devant de la scène.
Aux États-Unis, être noir, blanc,
asiatique ou « arabes » (en fait, natifs du Moyen-Orient), c’est être
d’une des « races » différentes : les « hispaniques »,
eux, sont considérés comme de « race » blanche, mais d’une « ethnie »
différente (sous-entendu, « de la normale », dans le beau pays de
Trump).
La mention « race » qui
serait totalement interdite chez nous se trouve sur la majorité des documents officiels
américains. Lorsque les États-Unis seront de nouveau gouvernés par un homme
adulte (même un peu vieux, semble-t-il !) et non par un vieux gamin détraqué,
fils à papa au QI de pince à linge, il faudrait peut-être songer à supprimer cette
mention et la remplacer au besoin (mais en est-il réellement besoin !),
par le mot « ethnie » ou « origine ethnique » (ce qui est
également interdit chez nous et j’espère que ÇA LE RESTERA !)
En tous cas, ce brocardage d’un mot
honni et haineux, serait-il plus utile que de brocarder Autant en emporte le
vent (le film et le livre) comme l’ont fait certaines plateformes,
brocardage qui atteint la France puisque le Grand Rex, pour fêter sa
réouverture le 22 juin, devait ressortir le film et qui, du coup, s'en est abstenu.
Tout-à-coup, ô miracle, les
États-Uniens ont découvert que ce film vénéré avec 13 nominations aux oscars et
10 statuettes remportées, champion hors catégorie du tiroir-caisse jusqu’en
1963, adapté d’un livre « dévoré » au nord comme au sud et par les
lecteurs de « race » blanche comme par les lecteurs de « race »
noire et prix Pulitzer 1937, les Américains, donc, viennent de découvrir qu’Autant
en emporte le vent faisait l’apologie de cette société esclavagiste du Sud « emportée
par le vent », le vent mauvais du Nord qui laissait les profiteurs de
guerre (« Carpetbaggers » qui arrivaient avec leurs sac en
tapisserie), accompagnés de « nègres voyous » qu’on avait affranchis « un
peu trop tôt » piller le Sud « so romantic » de Scarlett O’Hara
qui sera victime d’une agression de ces « sales nègres », punis, fort
heureusement par une expédition punitive de ce que ni le livre, ni le film, n’ose
tout de même nommé : le Ku-Klux-Klan.
Il est question maintenant de ressortir
le film assorti d’un préambule qui ressemblerait furieusement à celui qui accompagnait
les copies destinées aux pays européens et qui expliquait le contexte
historique de la Sécession des douze états du sud et de la guerre qui s’en
suivit. Lors d’une des (nombreuses) ressorties du film, ce préambule fut
supprimé et remplacé par celui qui apparaît dans la version originale où il est
précisément question d’un pays de « chevaliers et de champs de cotons
appelé le Vieux Sud […] un monde à jamais disparu de chevaliers et leurs
charmantes dames, de maître et d’esclave qu’on ne trouve plus que dans les
livres et qui n’est plus que le souvenir d’un rêve. »[1]
Bien sûr, ce « rêve » devait
chez les noirs plus s’assimiler à un cauchemar ! Même si Selznick fit
remplacer le terme « negroes » par « darkies »
dans la bouche de Gerald O’Hara dans une scène avec Scarlett (la VF a conservé
le terme de « nègres »), il est quand même question d’« inférieurs »
et ça, non seulement c’est dit, mais c’est très vraisemblablement pensé.
Comme l’a fait très justement remarquer
Pascal Blanchard, censurer ces termes, certes choquants, fera le jeu des
révisionnistes du futur qui feront remarquer qu’il n’y a aucun terme offensant
dans ce film (et dans le livre qu’on veut également « revisiter »
pour le rendre politiquement correct), à partir du moment où on les aura
supprimés : restera l’idéologie !
« Ceux qui ne peuvent se
souvenir du passé sont condamnés à le répéter » (George Santayana)
[1] Ce texte qui accompagne le
générique est de Ben Hecht, un des (très) nombreux scénaristes ayant travaillé
sur le film et non crédité.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire