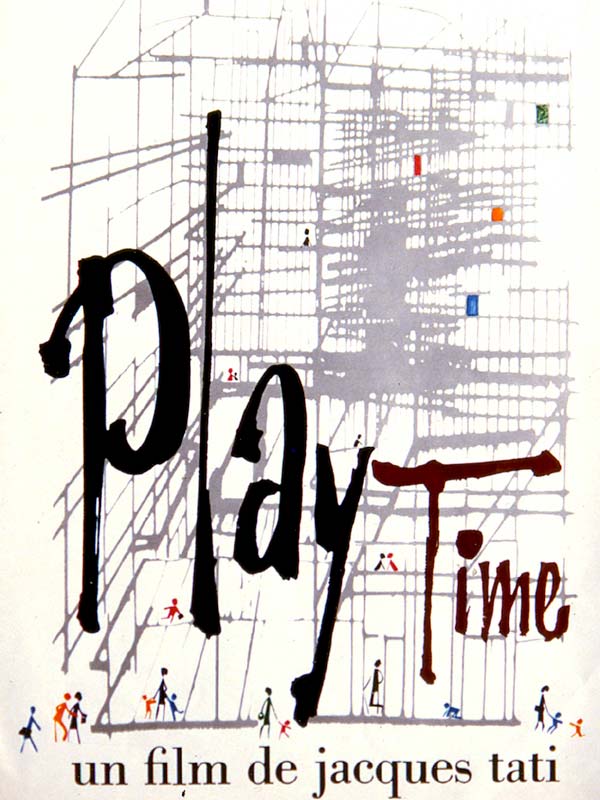 ***
***
Play Time
(1967) de Jacques Tati
Un
groupe de touristes américains qui vient d’arriver à Orly, est transporté en
ville.
Monsieur Hulot a, lui, un
rendez-vous dans le quartier d’affaires où sont logées les Américaines. Mais il
se perd dans les dédales de la société où il a rendez-vous et son interlocuteur
ne parvient pas à le retrouver.
Il se retrouve dans une exposition
d’inventions « domestiques » (portes qui claquent en silence, balais
équipés de phares pour aller sous les meubles, poubelles en forme de colonne
corinthienne, etc…).
En sortant de l’exposition, il
rencontre un copain de régiment qui tient à lui montrer son appartement
ultra-moderne.
Puis, il rencontre un autre copain de régiment qui est
portier dans un restaurant chic et « ultra moderne », le Royal Garden
qui est inauguré le soir-même, alors que les travaux ne sont pas tout-à-fait terminés.
Un
Oscar, ça peut rendre fou !
En France, nous avons en deux
exemples : en 1958, Jacques Tati obtient l’Oscar du meilleur film étranger
pour Mon oncle.
L’autre cas, c’est Clouzot. La Vérité n’a pas
obtenu l’oscar, mais il a fait partie des nominations. Le film a remporté un
grand succès aux U.S.A. (Bardot oblige !) et les producteurs américains,
toujours prêts à voler au secours du succès, décidèrent de lui offrir tout ce
qu’il voulait pour son prochain film. Le budget « no limit » montera
à la tête de Clouzot qui ne fera qu’entamer le tournage catastrophique de L’Enfer,
un film dont il ne reste que quelques rushes et un « no making of »[1].
Play Time, même si le film ruina Tati, finit par se faire en
dépit des exigences perfectionnistes du réalisateur qui fit craquer une bonne
partie de l’équipe. Ce film, il le voulait parfait, il le réalisa en 70 mm, fit
construire des décors pharaoniques (tout un quartier d’affaires) à l’image des
décors du film Intolerance de Griffith et une myriade de petits rôles qui sont
ici un peu plus que des figurants.
Je me faisais une joie de revoir Play
Time. Dire que mon passé m’a « sauté à la figure comme un chien
enragé »[2], serait un peu
excessif !
Mais Play Time m’a un peu déçu,
principalement toute la critique un peu lourde de la « modernité »,
une modernité qui, bon an, mal an, a dépassé ses 50 ans.
Quand on lit sous la plume d’Henry
Chapier que le film est un « monumental navet », on a quand
même un haut-le-cœur.
Mais la version de deux heures est
peut-être un peu trop longue, principalement, comme je l’ai dit plus haut, dans
sa première heure où certains gags sont quelquefois étirés, sans doute pour
donner plus de poids à la critique que « Monsieur Hulot » adressait à
la modernité, critique qui fait long feu.
Ça commence un peu à bouger dans
l’exposition que j’appellerais « Le Concours Lépine » avec ses portes
« qui ne claquent pas » (« inventées » par Reinhard
Kolldehoff, le caporal allemand de La Grande
vadrouille et le baron Konstantin
Von Essenbeck des Damnés
de Luchino Visconti) ou ces lunettes « qui permettent de se
maquiller », présentée par France Rumilly (la fameuse « religieuse à
la 2 CV » de la série des Gendarmes).
La scène d’ouverture à Orly (seul le
plan extérieur de l’aérogare a été tourné sur place) reste superbe.
Mais le sommet du film, c’est
l’inauguration du « Royal Garden », le restaurant qui ouvre alors que
les travaux ne sont pas finis. On n’en finirait plus de citer les gags qui
jalonnent la (longue) séquence.
Play Time, c’est avant tout un chef d’œuvre de mise en scène et
on sait que Tati a failli devenir fou et rendre fou son équipe par son
perfectionnisme. Peut-être n’était-il pas à même, lui le
« bricoleur » de génie, de gérer le budget colossal d’une
superproduction, ce qu’est Play Time, même si, au fond le film est une
continuité (et non une suite) de Mon oncle dont les dimensions étaient autrement modestes.
Tati filme même des « tableaux
vivants » comme dans un « split screen » (dans une séquence qui
est à la base, d’après ce qu’il en a dit, du choix du format 70 mm), avec ces
« appartements modernes » dans lesquels les occupants ont les yeux
rivés sur la télévision, ce qui donne l’impression qu’ils s’observent l’un
l’autre alors que nous voyons toute leur vie depuis la rue. Hulot échappe de
justesse à la projection des « films de vacances » chez son
« copain de régiment ».
C’est cette partie du film qui nous
évoque les toiles les plus connues du peintre américain Hopper.
D’ailleurs, il faut bien dire que ce
sont les décors qui « font » un peu le film, ces décors très coûteux
que Tati a fait construire et qu’il désirait rendre pérenne pour servir à d’autres
cinéastes après lui, comme ça se pratiquait pendant l’âge d’or de
Hollywood : les décors des films A étaient utilisés dans les films de séries
B, films qui servaient aussi à permettre à de jeunes cinéastes de « se
faire la main ».
Ce Paris reconstitué fait surtout
penser à la Défense sans son parvis. De Paris, on ne voit que des reflets dans
les vitres (la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Sacré Cœur). D’ailleurs,
toute la première partie du film joue sur les reflets dans des vitres si bien
nettoyées qu’on ne les voit pas toujours : un des personnages s’y casse le
nez (au sens propre).
Alors bien sûr, on préfèrera la
séquence du restaurant « Royal Garden » qui va se déglinguer au fur
et à mesure de son inauguration, avec ses pannes multiples et ses chaises qui
se décalquent sur les vestons. A la caisse, on reconnaît Marie-Pierre Casey
(madame Pliz).
Le « carrousel final » sur la
place est, en revanche, un peu lourdingue.
Mais Play Time reste un film
fascinant (malgré ces quelques réserves), un des rares films produits en 70 mm
en France.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire